
Site d'information pour les salariés de la CERP Rouen groupe ASTERA

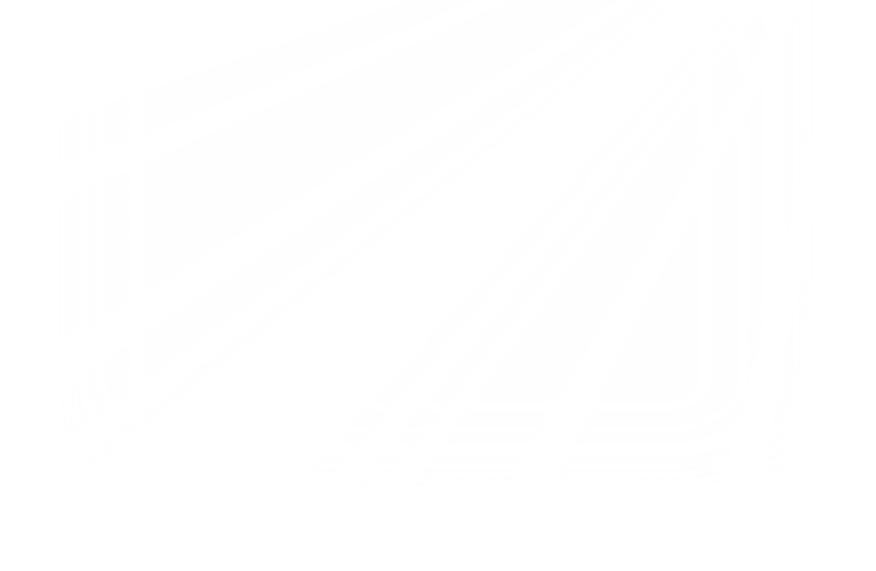
Histoire de la CGT
1895 : Congrès constitutif de la confédération générale du travail CGT à Limoges 1900 : Création du journal La Voix du peuple, organe de la CGT.
1904 : Le congrès de Bourge adopte la revendication de la journée de 8 heures.
1906 : La charte d'Amiens adoptée en congrès, donne au syndicalisme confédéral quelques-uns de ses traits spécifiques : la lutte des classes, la lutte quotidienne pour des améliorations immédiates ainsi que son indépendance vis-à-vis des organisations politiques.
1909 : le premier numéro de la Vie ouvrière, l'ancêtre de La Nouvelle Vie ouvrière (NVO) qui est toujours la revue de la CGT.
1914 : La CGT organise des manifestations syndicales contre la guerre. Le 3 août, c'est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Le 4 août, la CGT rallie l'Union sacrée.
1919 : 25 mars : loi sur les conventions collectives. 28 mars : loi supprimant le travail de nuit dans les boulangeries. 23 avril : lois sur la journée de 8 heures. La CGT passe à un effectif de 1 million et demi d'adhérents. Création de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
1920 : inauguration du Conseil économique et social (initiative de la CGT). Vote de la loi relative au droit syndical. Le 1er mai : la CGT décide la grève générale. En 15 jours, on compte 1,5 million de grévistes. À la suite de ce mouvement, la 11e chambre du tribunal correctionnel ordonnera la dissolution de la CGT, sanction qui ne sera jamais appliquée.
1921 : Naissance du journal Le Peuple, organe officiel de la CGT.
1925 : La CGTU revendique deux semaines de congés payés et appelle à la réunification de la CGT.
1930 : Vote définitif de la loi sur les assurances sociales
1934-1935 : Maurice Thorez donne son aval à un rapprochement des deux CGT qui aboutira à un programme de Front populaire.
1936 : Réunification de la CGT et de la CGTU lors du congrès de Toulouse, une vague de grèves partout en France, les accords Matignon, entre la CGT et le patronat (CGPF) est signé et en découleront les lois sociales sur les conventions collectives, l'institution de délégués d'atelier, le relèvement des salaires, l'instauration de quinze jours de congés payés et la semaine légale de 40 heures.
1939 le bureau confédéral de la CGT vote une déclaration excluant les militants qui refusent de condamner le pacte germano-soviétique.
1940 : peu avant sa chute le gouvernement fait voter les 60 heures de travail par semaine, le nouveau gouvernement de Vichy dissout les centrales syndicales ouvrières et patronales, dont la CGT ; les fédérations peuvent cependant théoriquement continuer leur action.
1941 : Promulgation de la Charte du travail interdisant les grèves et le lock-out dès l'hiver 40/41, parution des premiers journaux clandestins. Développement des « comités populaires » qui organisent les premières luttes revendicatives majoritairement de militants CGT.
1943 : Les Accords du Perreux, signés le 17 avril reconstituent la CGT. La CGT réunifiée participe à la constitution du Conseil national de la Résistance (CNR)
1944 : Publication le 15 mars du programme du CNR (définissant les nationalisations, la Sécurité sociale et les comités d'entreprises) où la CGT est représentée par Louis Saillant. La CGT clandestine appelle à la grève générale pour la Libération. Le lendemain, c'est le déclenchement de l'insurrection parisienne, qui prendra fin avec la Libération de Paris et l'arrivée du Général de Gaulle. La CGT s'installe au grand jour dans ses locaux du 213, rue La Fayette : c'est la fin de la clandestinité avec une première réunion de son bureau. Le 8 septembre, son journal, La Vie ouvrière, qui avait paru sous forme de tract pendant l'occupation, reparaît au grand jour. Création de la Confédération générale des cadres (CGC).
1945 : Début des nationalisations, création des comités d'entreprise et mise en place de la Sécurité sociale. Création de la Fédération syndicale mondiale (FSM) à laquelle adhère la CGT.
1946 : promulgation du Statut Général des Fonctionnaires.Dans le cadre de la nationalisation d’EDF-GDF,création du Conseil central des œuvres sociales (CCOS) financé sur le 1 % des bénéfices hors taxes des ventes d'électricité et de gaz de l'entreprise étatisée.
1947 : La CGT obtient 59 % des voix lors des premières élections à la Sécurité sociale. Suite à des grèves un accord CGT / CNPF pour une augmentation de 11 % est trouvé. La division s'accentue à la CGT entre la majorité et la minorité à propos du plan Marshall , c'est la scission et la création par les minoritaires (qui refusent la soumission au PC) de la confédération « CGT-Force Ouvrière » (FO).
1950 : Vote de la loi sur les Conventions collectives
1953 : Retraites : la CGT puis la CFTC appellent à une journée d'action des secteurs publics et nationalisés contre le recul de l'âge à la retraite. Les confédérations CGT, FO, CFTC appellent à la grève générale.
1954 : début de la guerre d'Algérie. Durant tout le conflit, la CGT soutient « les revendications des Algériens et leurs aspirations nationales. »
1962 : Une manifestation anti-OAS durement réprimée fait 9 morts, pour la plupart membres de la CGT, au métro Charonne. Les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie.
1968 : grève générale : en mai et juin, sept millions de travailleurs en grève occupent leurs usines. Constat de Grenelle : augmentation de 35 % du salaire minimum, reconnaissance de la section syndicale à l'entreprise.
1970 : accord CGT-CFDT, le 15 décembre, sur des revendications prioritaires : revalorisation du SMIC, retraite à 60 ans, semaine de 40 heures, emploi, heures de formation syndicale.
1988 : Mouvement de grève des infirmières à l'appel d'une coordination nationale qui réclame notamment une augmentation significative des salaires. Après la défection des autres syndicats, la CGT est seule à soutenir le mouvement.
1995 : importants mouvements de grève contre le plan d'Alain Juppé (novembre-décembre), dans lequel s'illustre Bernard Thibault.
1999 : la CGT adhère à la Confédération européenne des syndicats, Bernard Thibault est élu secrétaire général.
2002 : Élections prud'homales : la CGT reste en tête avec 32,13 % des voix (-0,98 %) devant la CFDT 25,33 %.
2003 : importants mouvements sociaux contre le projet de Loi Fillon sur les retraites et grand mouvement social contre le Contrat première embauche, disposition législative finalement abandonnée.
2008 : Élections prud'homales : la CGT conforte sa position de premier syndicat avec 34,00 % des voix (+1,87 %) devant la CFDT, en baisse à 21,81 %.
2010 : le syndicat est présent lors des manifestations et grèves contre la réforme des retraites.
2012 : élections dans les TPE (très petites entreprises, employant moins de 11 salariés), la CGT est la première organisation de France.Thierry Lepaon est élu secrétaire général lors du 50e congrès. Philippe Martinez est élu secrétaire général en remplacement de Thierry Lepaon après la démission de ce dernier.
2016 : la CGT participe activement aux grèves et manifestations du printemps 2016 contre la loi Travail. Toutes les raffineries de France sont en grève le 24 mai. Le gouvernement passera cette loi par le 49,3 avec le soutien du MEDEF de la CFDT et contre l’avis défavorable de 70% des Français.
2017 : élections dans les TPE (très petites entreprises, employant moins de 11 salariés), la CGT est placée en première avec 25% des voix et 10 points devant la CFDT